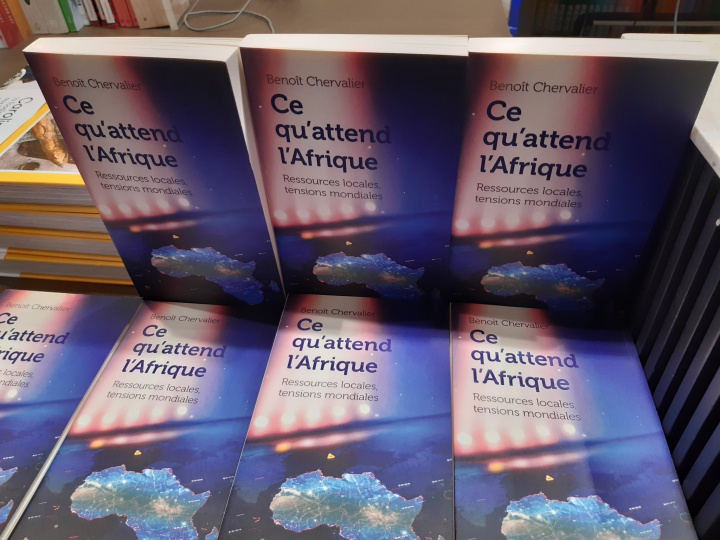
Ancien haut fonctionnaire à la Banque africaine de développement, banquier d’affaires, vice-président Afrique du Medef, président Afrique de Business Europe et enseignant à l’ESSEC à Rabat, Benoît Chervalier est l’une des voix françaises qui connaissent le mieux les dynamiques africaines. Il vient de publier «Ce qu’attend l’Afrique : ressources locales, tensions mondiales (Éditions de l’Aube)», un ouvrage nourri par un quart de siècle d’expérience sur le terrain.
Par R. Mouhsine
Lorsqu’on pose la question au banquier de deux cas emblématiques de pays africains ayant observé des trajectoires économiques divergentes ces toutes dernières années, il répond spontanément: la Zambie et le Maroc. En novembre 2020, la Zambie a fait officiellement défaut sur sa dette résultant d’un endettement obligataire excessif et onéreux, dans un contexte économique international détérioré.
Alors que le Maroc, en septembre 2020, a emprunté sur les marchés de capitaux internationaux à des taux historiquement bas (la Zambie avait emprunté, fin 2015, 1 milliard de dollars à 9,625% contre 1,375%/2% pour le Maroc pour le même moment et à maturité comparable).
Ce parcours chaotique n’est pas anecdotique. Il sert d’étude de cas au nouveau livre de Benoît Chervalier, «Ce qu’attend l’Afrique : ressources locales, tensions mondiales (Éditions de l’Aube)», pour illustrer la diversité des trajectoires africaines et la nécessité d’en finir avec les lectures monolithiques du continent.
Sortir de la vision uniforme du continent
L’une des affirmations du livre est claire : l’Afrique n’est pas un tout homogène. On a souvent tendance à traiter le continent comme un ensemble uniforme, une région où tout le monde partagerait la même langue, la même histoire, les mêmes icônes. Une erreur récurrente, que Chervalier s’attache à corriger en multipliant les angles, les contextes et les exemples domestiques et locaux. Cette diversité est à ses yeux indispensable pour comprendre ce qui s’y joue, économiquement comme politiquement. Lorsque Chervalier commence à enseigner la finance, la géopolitique et le «Doing business en Afrique», le narratif était l’Afrique en ascension : le Africa Rising, en anglais, incarné par la Une de The Economist en mai 2010.
Entre 2004 et 2013, le continent affiche plus de 5% de croissance annuelle moyenne. L’époque est alors portée par un discours volontariste, donnant l’image d’un continent en plein décollage. Mais la décennie suivante est marquée par une succession de chocs. Il cite notamment celui du pétrole que l’on a trop tendance à oublier : au début de l’année 2014, «le baril est à près de 120 dollars», avant de s’effondrer «à 60 dollars à l’été», puis «à 28 dollars» début 2016.
Pour les économies extractives - Angola, Algérie, Nigeria, Gabon, Tchad -, l’impact est brutal : dégradation des comptes publics, pressions sur la dette, contraction des marges de manœuvre. Dans ce nouveau contexte, l’accès aux marchés financiers internationaux devient plus coûteux et plus risqué. La Zambie en a subi la démonstration.
Un livre né du terrain
Pour expliquer ces évolutions, Chervalier s’appuie sur un long compagnonnage africain. «Ce livre, j’ai voulu d’abord l’écrire sur la base de mes différentes expériences professionnelles, de mon engagement sur le continent africain maintenant depuis près de 25 ans», affirmet-il. Au fil de ces années, il s’est rendu dans quarante pays. «J’y ai également vécu, j’y vais extrêmement souvent. L’idée était de partir du terrain, des réflexions qui sont nourries du terrain, et d’en dégager une réflexion», fait-il savoir. Cette démarche est soutenue par un parcours particulièrement varié : ancien haut fonctionnaire de la Banque africaine de développement, chef d’entreprise, banquier d’affaires, acteur patronal et enseignant.
Autant de positions qui lui ont permis d’observer les évolutions du continent sous différents angles. L’enseignement occupe une place importante dans son approche. L’auteur enseigne depuis un peu plus de 15 ans à Sciences Po Paris et à l’ESSEC, notamment ici à Rabat. Au total, il a formé un peu plus de 1.000 étudiants, venus du Maroc, du Kenya, d’Afrique du Sud, de Côte d’Ivoire, mais aussi d’Inde, de Chine, du Japon, des États-Unis ou d’Europe.
Une expérience qui lui profère une vision comparative rare, nourrie de regards croisés. S’il refuse de distinguer artificiellement «étudiants africains» et «non-africains», il observe «des similitudes» et «des différences» entre eux, qui ne suivent pas forcément les frontières géographiques. Ce constat nourrit son intuition : la compréhension de l’Afrique passe par la reconnaissance de sa pluralité.
Un moment décisif Par-delà les chiffres et les cycles, l’auteur souligne que le continent traverse des mutations plus profondes (politiques, sociales, technologiques). L’Afrique se trouve aujourd’hui «à un carrefour de son histoire».
Le chemin qu’elle choisira influencera durablement son avenir, mais également celui du monde, et notamment de l’Europe, engagée elle aussi dans une réflexion sur sa souveraineté. En conjuguant expériences de terrain, responsabilités institutionnelles et regard pédagogique, «Ce qu’attend l’Afrique: ressources locales, tensions mondiales» propose une lecture nuancée d’un continent trop souvent ramené à un récit unique. Un ouvrage qui invite, sans emphase ni simplification, à considérer l’Afrique telle qu’elle se déploie : diverse, complexe, et engagée dans des transformations profondes.